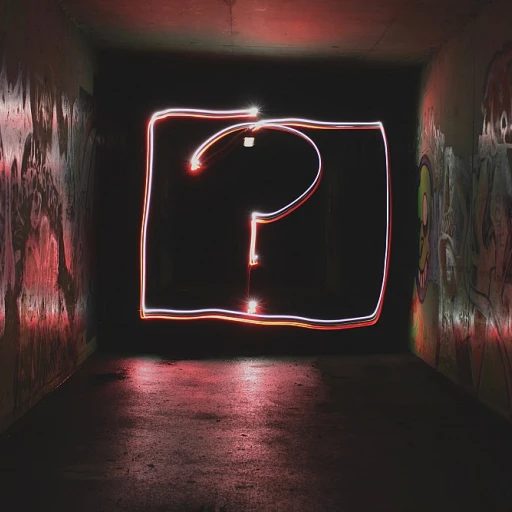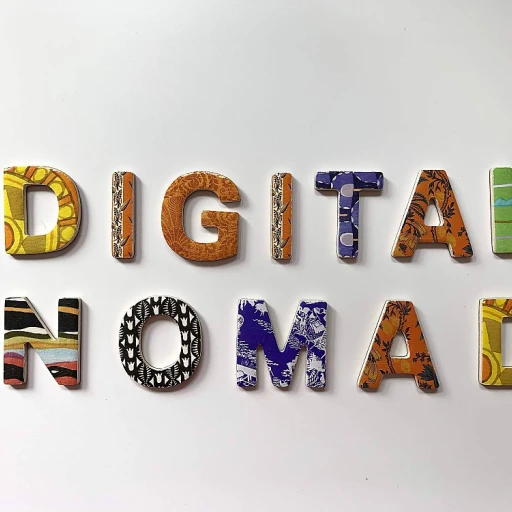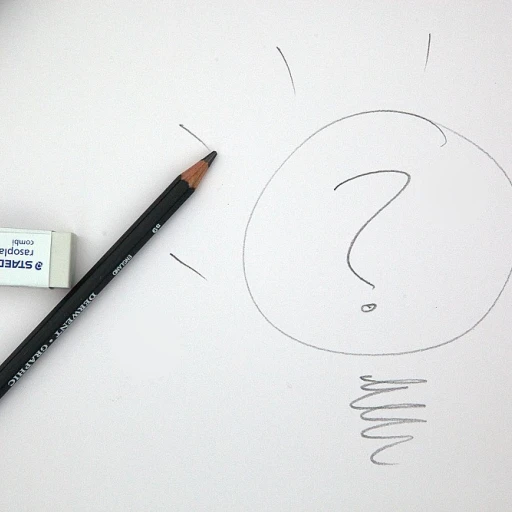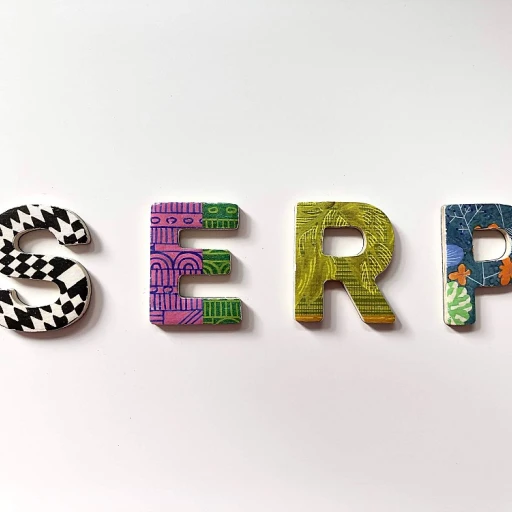L'origine de l'écriture inclusive
De l'origine au débat sociétal
L'écriture inclusive n'est pas née de la dernière pluie. Depuis longtemps, on débat des impacts de la langue sur les représentations de genre. Déjà en 1984, des universitaires comme Eliane Viennot ont mis en lumière l'androcentrisme de la langue française. Les débats se sont intensifiés à partir des années 2000, notamment sous l'impulsion de féministes militantes et des mouvements pour l'égalité des sexes.
En effet, beaucoup considèrent que la langue française, avec son systématique usage du masculin générique, invisibilise les femmes. Les titres de métiers, fonctions et titres honorifiques en sont un bon exemple. Au Québec, l'Office québécois de la langue française a émis des lignes directrices pour favoriser la féminisation des titres de métiers dès les années 1980.
Les défenseurs de l'écriture inclusive aspirent à une langue plus égalitaire et non discriminatoire en adaptant l'orthographe et la syntaxe, ce qui suscite des discussions parfois houleuses.
Des chercheurs comme Pascal Gygax et Maria Candea ont démontré, grâce à des études linguistiques et psycholinguistiques, que l'usage du masculin générique influence les représentations mentales des locuteurs, renforçant les stéréotypes de genre. Par exemple, lorsque l'on parle de « médecins » au masculin, les gens imaginent le plus souvent des hommes. Ces données sont soutenues par des recherches telles que celles de Daniel Elmiger et de Raphael Haddad, qui soulignent l'importance d'une communication neutre et non stéréotypée.
Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas là. Ce sujet est brûlant et génère encore aujourd'hui des controverses et oppositions de toutes parts. D'autres parties de ce blog aborderont les règles concrètes de l'écriture inclusive ainsi que son rôle dans l'éducation et à l'international.
Les règles de l'écriture inclusive
Les règles principales à connaître
L'écriture inclusive repose sur quelques règles essentielles à intégrer pour un usage correct et fluide dans la langue française. Voici une présentation détaillée de ces règles, appuyée par des exemples concrets et des avis d'experts.
Tout d'abord, la règle des accords typographiques. Cette règle propose d'accorder en genre les noms de métiers, fonctions, grades ou titres lorsqu'ils sont désignés et appliqués à des femmes. Ce type de féminisation est devenu plus courant et est encouragé par de nombreux organes officiels comme l'Académie Française. Par exemple, on écrira "une autrice" au lieu de "un auteur", et "une professeure" au lieu de "un professeur".
Quant à la règle des points médians, elle est un peu plus controversée. Il s'agit d'insérer des points médians (·) pour inclure à la fois le genre masculin et féminin dans un même mot. Par exemple, "ami·e·s" pour désigner à la fois les amis et les amies en un seul mot, ou "élèves·s" pour inclure enfants filles et garçons. Selon l'avis de certaines linguistes comme Eliane Viennot, cette pratique permet de mettre en avant la diversité de genre sans alourdir les textes.
Certaines règles de rédaction épiçène visent à privilégier des formules neutres ou générales. Par exemple, le mot "personnel" au lieu de "employés" ou "personnes" au lieu de "hommes" ou "femmes". Dans le Ministère de l'Éducation nationale, la circulaire du 21 novembre 2017 prône l'usage de termes moins genrés et encourage la simplification des textes pour une lecture inclusive.
Les ajustements modernes du langage
Le langage inclusif ne se limite pas à faire usage des points médians mais inclut aussi des ajustements linguistiques qui permettent de rendre chaque individu représenté sans distinction de leur genre. De nombreux organismes, tels que le Conseil de l'égalité entre femmes et hommes, recommandent l'adoption de ce type de langage. En France, cette initiative est partagée par différents acteurs de l'éducation et de la communication comme le sociolinguiste Pascal Gygax.
Le Canada, notamment par l'Office québécois de la langue française, est un acteur majeur dans la promotion et la diffusion de l'écriture inclusive. Un manuel intitulé "La féminisation des titres et des fonctions" est désormais largement adopté dans les administrations publiques et écoles.
Pour finir, à l'ère du numérique, les pratiques d'écriture inclusive trouvent aussi des applications dans les projets digitaux. Les réseaux sociaux, les sites web et même les campagnes publicitaires intègrent des éléments linguistiques inclusifs, comme le montre l'initiative Skyblog Photographie: un voyage à travers l'objectif. En adoptant un langage plus inclusif, ces plateformes réduisent les stéréotypes sexistes et promeuvent l'égalité.
L'impact de l'écriture inclusive sur la langue française
Les changements induits par l'écriture inclusive
L'adoption de l'écriture inclusive a perforé divers aspects de la langue française, surtout dans l'écrit. Elle cherche à abolir la prédominance du masculin générique pour instaurer un langage plus égalitaire. Parmi les principaux changements apportés par cette écriture, on trouve l’usage du point médian. Par exemple, au lieu d'écrire « les étudiants », l'écriture inclusive propose « les étudiant·e·s ». Cette pratique s'inscrit dans un effort plus large de féminisation des noms de métiers et de fonctions.
Évolution et adaptation de la grammaire française
Le Conseil d'État a, en 2019, édicté une circulaire pour encourager l’adoption de formules épicènes dans les textes administratifs. Cette régulation a conduit à des ajustements grammaticaux importants, bien que certains puristes linguistiques restent sceptiques. En France, l'Académie française, bastion de la langue, s'est montrée critique, qualifiant l'écriture inclusive de « péril mortel » pour la langue de Molière (source : global-digital).
Les avis divergents des experts
Des linguistes comme Eliane Viennot et Pascal Gygax soutiennent cette évolution, arguant qu’elle favorise une plus grande diversité et inclusion. De l'autre côté, des figures comme l’ancien ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, s'opposent à cette écriture, la trouvant compliquée et inutile. Monique Candea, professeure de sociologie à l’Université Grenoble Alpes, met en lumière les bénéfices pour la démocratie linguistique et la représentation égalitaire.
Exemples de mise en pratique
Quelques grandes entreprises et institution se sont pleinement engagées dans cette voie. Par exemple, l'ESF (École Supérieure de Femmes) a intégré l'écriture inclusive dans ses documents officiels et supports de communication. De plus, la mairie de Paris a décidé de l'appliquer dans tous ses textes administratifs. Ce mouvement est également visible dans d'autres régions comme le Québec, où l'Office québécois de la langue française encourage les initiatives d'écriture inclusive.
L'écriture inclusive et l'égalité femmes-hommes
L'impact de l'écriture inclusive sur l'égalité femmes-hommes
Le débat autour de l'écriture inclusive n'est pas seulement une question de grammaire ou de syntaxe : c'est un enjeu de société touchant directement à l'égalité entre les femmes et les hommes. Depuis quelques années, ce sujet suscite de nombreux échanges et parfois même des controverses, souvent parce qu'il remet en question des siècles de conventions linguistiques où le masculin générique prédominait.
La féminisation des noms et des métiers
L'une des principales mesures pour promouvoir l'égalité femmes-hommes à travers l'écriture inclusive est la féminisation des noms de métiers. Par exemple, utiliser « autrice » au lieu de « auteur » ou encore « écrivaine » au lieu de « écrivain ». Cette initiative est en effet soutenue par des figures influentes comme Éliane Viennot, historienne et militante féministe, qui souligne l'importance de ces changements dans la reconnaissance des femmes dans tous les domaines professionnels.
Des statistiques révélatrices
Une étude menée par l'Université de Genève a révélé que l'utilisation du masculin générique tend à renforcer les stéréotypes de genre: seulement 15% des enfants imaginent une femme lorsqu'on leur parle d'un « médecin », comparé à 82% lorsqu'on utilise « médecin.ne ». Ces chiffres illustrent l'impact concret qu'a le langage sur nos perceptions et montrent en quoi l'utilisation de l'écriture inclusive peut aider à déconstruire les stéréotypes sexistes.
Les avis des experts et les initiatives gouvernementales
Pascal Gygax, psycholinguiste et professeur à l'Université de Fribourg, affirme que « notre imaginaire social est fortement influencé par les structures linguistiques que nous utilisons ». En France, le gouvernement a également pris des initiatives pour intégrer l'écriture inclusive, notamment à travers le Conseil de l'égalité entre les femmes et les hommes, présidé par Jean-Michel Blanquer. Cependant, cette démarche rencontre des résistances, y compris au sein de l'Académie Française.
Une opposition notable
En 2017, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe avait demandé aux ministères de ne pas utiliser l'écriture inclusive dans les documents officiels, arguant qu'elle compliquait inutilement la langue française. Cependant, des pays comme le Canada démontrent une ouverture bien plus grande à ces pratiques, notamment à travers l'Office québécois de la langue française.
Conclusion partagée
Si l'écriture inclusive ne fait pas encore l'unanimité, son rôle dans l'égalité femmes-hommes semble indéniable. Les discussions se poursuivent et montrent que les mots ont un pouvoir, celui de façonner des sociétés plus équitables.
Les controverses autour de l'écriture inclusive
Les réactions des institutions nationales et internationales
L'Académie française, l'une des principales institutions de la langue française, s'est fermement opposée à l'écriture inclusive. En 2017, elle l'a qualifiée de « péril mortel » pour notre langue en argumentant que l'écriture inclusive compliquerait l'apprentissage du français et nuirait à son efficacité.
Le ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a également pris position contre l'écriture inclusive. En 2017, il a interdit son utilisation dans les textes officiels et les manuels scolaires, arguant qu'elle alourdissait inutilement le langage et entravait la clarté des messages pédagogiques.
Les avantages et inconvénients selon les experts
L'écriture inclusive a ses partisans et ses détracteurs. D'un côté, des experts comme Élaine Viennot, historienne et professeure à l'Université de Grenoble, soutiennent que cette forme d'écriture permettrait de contrer les stéréotypes de genre et de promouvoir l'égalité entre les sexes. Elle a déclaré : « L'écriture inclusive est une mesure simple pour faire bouger les mentalités et promouvoir plus d'égalité ».
De l'autre côté, des linguistes comme Pascal Gygax du Département de psychologie de l’Université de Fribourg en Suisse, pointent du doigt les inconvénients potentiels. Ils estiment que l'écriture inclusive pourrait compliquer la compréhension des textes et freiner l'efficacité de la communication écrite. Selon Gygax, « L’introduction d’un ensemble de règles grammaticales supplémentaires pourrait perturber les lecteurs et ralentir la lecture ».
Études et recherches : les chiffres parlent
Plusieurs études ont été menées pour évaluer l'impact de l'écriture inclusive. Une enquête réalisée par la fondation EFS en 2018 a révélé que 63 % des participants estimaient que l'écriture inclusive compliquait la lecture d'un texte. Cependant, une autre étude menée par l'université de Lorraine en 2019 a montré que 58 % des étudiants interrogés étaient favorables à l'intégration de l'écriture inclusive dans les manuels scolaires, soulignant son importance pour l'égalité des genres.
Le poids de l'opinion publique
Dans la rue, les avis sont partagés. Tandis que certains voient l'écriture inclusive comme un progrès nécessaire, d'autres y voient un changement inutile et perturbateur. Un sondage Ifop de 2020 a indiqué que 54 % des Français se disent opposés à l'écriture inclusive, reflétant un grand débat national.
Maria Candea, sociolinguiste à l'Institut du Monde Anglophone de Paris III, observe que « Cette opposition est souvent liée à des habitudes d’écriture profondément ancrées et à une peur du changement linguistique ».
Des initiatives pour clore le débat
Pour apaiser les tensions, certains proposent des solutions hybrides, comme la féminisation des noms de métiers ou l'utilisation du point médian avec parcimonie. En 2020, le Conseil pour l'égalité entre les femmes et les hommes a recommandé un usage modéré de l'écriture inclusive pour éviter de heurter les sensibilités tout en promouvant une langue plus just
N'auriez-vous pas des exemples ou des cas pratiques d'utilisation de l'écriture inclusive qui auraient fait polémique dans l'histoire française récente? Partagez vos opinions dans les commentaires!
L'écriture inclusive dans l'éducation nationale
Les initiatives du ministère de l'Éducation nationale
Jean-Michel Blanquer, alors ministre de l'Éducation nationale, a exprimé en 2017 sa désapprobation vis-à-vis de l\u2019écriture inclusive, la qualifiant de \u00abcomplexifiant\u00bb. Selon Blanquer, l'emploi de cette méthode pourrait rendre plus difficile l'apprentissage du français pour les élèves. Il a déclaré : \u00abL’écriture inclusive disperse nos forces.\u00bb Cependant, d'autres voix au sein du ministère ont émis des avis divergents, soutenant que l'écriture inclusive est un outil nécessaire pour promouvoir l'égalité entre les sexes.Les positions des syndicats et associations
Certains syndicats enseignants, comme le SGEN-CFDT, ont défendu l'utilisation de l'écriture inclusive, arguant qu'elle participe à la lutte contre les stéréotypes sexistes. Eliane Viennot, historienne et défenseure de l'écriture inclusive, souligne que \u00able masculin neutre n'est plus tenable dans une société où l'on aspire à l'égalité réelle entre les femmes et les hommes\u00bb. En revanche, l’Académie française s’est fermement opposée à cette réforme, mettant en avant la complexité et la rupture avec les règles traditionnelles de la langue française.Les ressources pédagogiques et manuels scolaires
À partir de 2018, plusieurs éditeurs ont commencé à intégrer des exemples d'écriture inclusive dans leurs manuels scolaires. Une étude menée par Maria Candea et Pascal Gygax a révélé que 73 % des enseignants trouvent justifié l'usage de l'écriture inclusive dans l'éducation. Toutefois, cette initiative reste minoritaire et est souvent soumise à l'approbation individuelle des établissements et des enseignants.Le cas du Québec et les adaptations internationales
L’Office québécois de la langue française (OQLF) a également pris position sur le sujet, favorisant une approche plus inclusive de la langue. Bien que le Québec et la France partagent une langue commune, leurs positions sur l'écriture inclusive divergent. Au Québec, cette réforme est perçue comme un moyen de moderniser le langage et de refléter les valeurs égalitaires de la société.Témoignages et retours d’expérience
Dans un lycée de Grenoble, une enseignante, Monique Biron, a volontairement adopté l’écriture inclusive dans ses cours de français et remarque : \u00abLes élèves se sentent plus engagés et respectés lorsqu'ils voient que le langage s'adapte à eux plutôt que l'inverse.\u00bb Cette approche semble avoir un impact positif sur la perception et l'engagement des étudiants, bien que cette pratique continue de susciter des débats." }L'écriture inclusive à l'international
L'écriture inclusive au Québec
Le Québec est souvent cité comme un exemple en matière d'adoption et de promotion de l'écriture inclusive dans la langue officielle. L'Office québécois de la langue française (OQLF) joue un rôle clé dans cette démarche en fournissant des lignes directrices et en encourageant l'usage d'un langage épicène. Une de leurs publications, le Banque de dépannage linguistique, offre des recommandations précises sur la féminisation des noms de métiers et fonctions, ainsi que sur l'utilisation de formes neutres.
Un exemple notable de cette application est la féminisation des termes professionnels. L'usage de « professeure » au lieu de « professeur » pour désigner une femme dans cette profession est de plus en plus courant. Cette évolution est perçue comme un moyen de reconnaître et de valoriser la présence des femmes dans divers secteurs professionnels.
Des experts tels que Monique Biron et Eliane Viennot ont largement contribué aux discussions sur la féminisation des noms de métiers au Québec. En Europe, Pascal Gygax et Daniel Elmiger ont également examiné les impacts de ces pratiques sur la perception et les comportements sociaux.
L'écriture inclusive en France
En France, l'introduction de l'écriture inclusive a généré des débats houleux. L'Académie française s'est prononcée contre cette pratique, qualifiant l'écriture inclusive de « péril mortel ». Toutefois, plusieurs institutions et entreprises adoptent progressivement un langage plus neutre et inclusif. Le Ministère de l'Éducation nationale, dirigé par Jean-Michel Blanquer, a été critiqué pour son approche conservatrice, bien que certaines écoles et universités prennent des initiatives indépendantes pour promouvoir l'égalité femmes-hommes.
Édouard Philippe, ancien Premier ministre, a aussi exprimé des réserves sur l'usage de l'écriture inclusive dans les documents officiels, arguant que cela pourrait complexifier la langue française. Toutefois, des voix telles que celles de Maria Candea et Catherine Mallaval défendent l'idée que l'écriture inclusive contribue à une société plus égalitaire et demande une adaptation progressive des usages linguistiques.
Initiatives internationales
L'écriture inclusive dépasse les frontières de la Francophonie. Au Canada, mais aussi en Suisse, en Belgique et dans d'autres pays francophones, l'intérêt pour un langage plus inclusif grandit. Les publications académiques et les rapports comme ceux de Lorraine et de l'Université de Grenoble démontrent une volonté croissante d'adopter des pratiques linguistiques plus égalitaires.
Par ailleurs, Google et d'autres grandes entreprises technologiques adoptent de plus en plus des formes de communication inclusives dans leurs interfaces et leurs supports de formation. Cela reflète une tendance globale vers une communication qui représente équitablement les divers genres et identités.